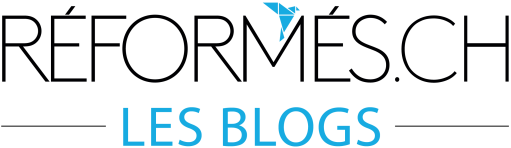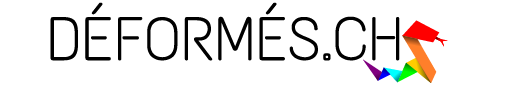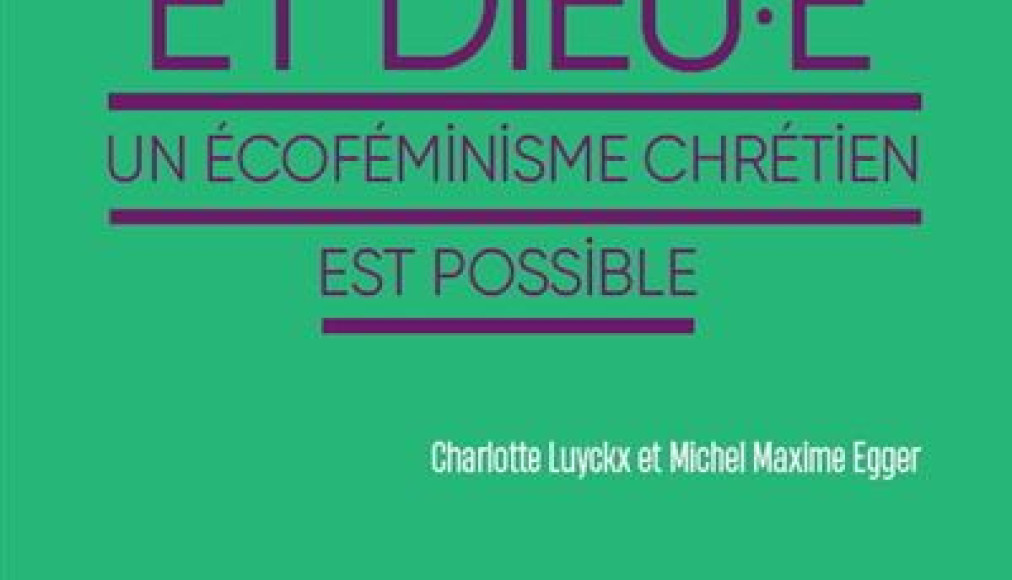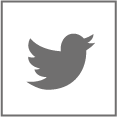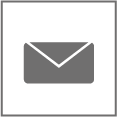L’écoféminisme, nouvel humanisme?
L’écoféminisme essaie de rendre visibles les liens entre plusieurs formes de domination: celles des femmes et de la nature. Pour bon nombre d’autrices de ce courant, la religion chrétien ne fait partie du problème: elle constitue l’un des cadres culturels contribuant à construire ces oppressions. Le christianisme y est donc vu comme un repoussoir, non comme une ressource. Pourtant,depuis au moins trois décennies, des écoféministes chrétiennes au Québec, en Inde, en Afrique du Sud, au Brésil et auxÉtats-Unis travaillent à se réapproprier les traditions chrétiennes pour y trouver d’autres représentations et interactions possibles avec les femmes et la nature.
Leurs oeuvres sont rarement traduites et éditées en français. Ce manque vient d’être réparé: une anthologie de leurs textes est parue en mai (voir note) sous la codirection de Charlotte Luyckx, docteure en philosophie, chargée de cours invitée à l’Université catholique de Louvain(Belgique) et chercheuse indépendante, et de Michel Maxime Egger, sociologue et écothéologien d’enracinement orthodoxe.
Qui sont les écoféministes chrétiennes?
Parmi elles, des théologiennes majeures: Rosemary Radford Ruether(1936-2022), Sallie McFague (1933-2019),qui a notamment forgé l’idée métaphorique du monde comme «corps deDieu», des spécialistes des liens entre éthique chrétienne et science comme Celia Deane-Drummond (1956). Marquée par une grande liberté, la pensée des écoféministes chrétiennes est souvent «ancrée dans l’expérience, intégrant aussi les dimensions d’intériorité, du corps, de la vie quotidienne, des expériences banales du quotidien», explique Charlotte Luyckx. Et comprend fréquemment une dimension politique.
Leurs principes et grandes idées?
Ces penseuses ne nient pas les dimensions patriarcales du christianisme, mais cherchent à compléter, dépasser, voire transformer cette vision en se basant sur le corpus biblique et la tradition chrétienne. Elles intègrent aussi de nouveaux récits cosmologiques, par exemple l’«hypothèse Gaïa», qui voit la planète Terre et le vivant reliés, comme un écosystème dynamique, en interactionpermanente.
Repenser toute la théologie chrétienne implique de questionner bon nombre de concepts. fondamentaux, mais l’une des discussions centrales «implique de changer notre manière de dire et comprendre le concept de Dieu», remarque Michel Maxime Egger. Plutôt qu’une image «monarchique» d’un père qui sous-tend «des caractéristiques de domination», des «schémas oppressifs envers les pauvres, les femmes, la terre», il s’agit ainsi de retrouver des caractéristiques féminines de Dieu dans la Bible. Mais aussi de trouver des traces de sa présence dans le monde et peut-être de «prendre congé de la transcendance», au minimum de repenser les liens entre transcendance et immanence.
Quelles limites?
Leur retour au corps peut faire craindre un retour à un certain essentialisme.
Et puisque l’objectif est de réformer la théologie, comment le faire à partir de concepts extérieurs à ce champ puisque les critères mêmes de validation de la théologie lui sont inhérentes? Enfin, leur vision du monde peut parfois apparaître comme une clé de lecture unique.
Quelles conséquences?
La force de ces autrices est de permettre de «redéfinir et réactualiser la tradition chrétienne, d’en faire quelque chose de vivant», estime CharlotteLuyckx. Elles offrent au christianisme la possibilité de tisser des liens avec d’autres champs, de mettre à jour les sources de spiritualité chrétienne oud’en trouver de nouvelles. Cette penséese distingue par une «capacité permanente d’autocritique et une non-absolutisation», observe Michel Maxime Egger. Autrement dit, il s’agit plutôt de rechercher, d’inventer, de questionner, non d’établir de nouveaux dogmes ou visions totalisantes. Reste à ce courant intellectuel désormais accessible de trouver des échos, réalisations et relais sur le terrain.

Charlotte Luyckx
Docteure en philosophie, chargée de cours invitée à l’Université catholique de Louvain (Belgique).

Michel Maxime Egger
Sociologue et écothéologien d’enracinement orthodoxe.